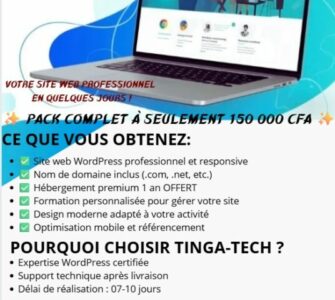Ce scénario n’est pas sans rappeler un précédent marquant dans la sous-région : le Burkina Faso, en 2014. À l’époque, le président Blaise Compaoré, après plus de 27 ans au pouvoir, avait entrepris de modifier l’article 37 de la Constitution pour pouvoir se représenter. L’opposition et une grande partie de la société civile avaient vu dans cette initiative une menace grave pour la démocratie. Ce fut l’étincelle d’une insurrection populaire qui, en quelques jours, força le chef de l’État à quitter le pouvoir… et le pays. Fait notable : c’est en Côte d’Ivoire que Blaise Compaoré a trouvé refuge, accueilli par le président Alassane Ouattara. Et s’il lui demandait ce que signifie fuir un palais présidentiel sous la pression du peuple. En pleine journée. Le goût amer du pouvoir perdu dans le chaos. L’histoire, comme bien, un professeur sévère est là : elle se répète quand on refuse d’en tirer les leçons. Ce que Blaise Compaoré a appris dans la douleur, Ouattara peut l’apprendre dans la sagesse.
L’histoire récente offre donc à la Côte d’Ivoire une leçon claire : la soif de prolonger un mandat au-delà des limites raisonnables peut ouvrir la porte à des bouleversements imprévisibles. Les autorités ivoiriennes gagneraient à méditer sur cet épisode burkinabè. Blaise Compaoré lui-même, s’il devait prodiguer un conseil, reconnaîtrait sans doute qu’un départ volontaire, dans le respect des règles constitutionnelles, est souvent plus honorable et bénéfique pour l’héritage politique qu’un maintien contesté au pouvoir.
Dans un contexte où la mémoire des crises passées reste vive, où les fractures politiques et ethniques n’ont pas totalement cicatrisé, l’annonce de la nouvelle candidature d’Alassane Ouattara risque de rallumer des tensions latentes. Les marches de l’opposition, les discours enflammés et la crispation politique pourraient dégénérer en affrontements, fragilisant ainsi les acquis économiques et sociaux patiemment construits depuis plus d’une décennie.
Renoncer à un quatrième mandat ne serait pas un signe de faiblesse, mais un acte de grandeur politique. Ce serait offrir au pays une transition apaisée, ouvrir le champ à un renouvellement générationnel et consolider la culture démocratique ivoirienne. La stabilité nationale et la crédibilité internationale de la Côte d’Ivoire s’en trouveraient renforcées.
De plus, cette décision couperait court à l’argument selon lequel la compétition électorale serait verrouillée au profit d’un candidat unique. Les figures politiques recalées ou marginalisées auraient ainsi la possibilité de présenter leurs programmes, enrichissant le débat public et offrant aux électeurs un véritable choix.
En réalité, l’avenir politique d’un pays ne devrait jamais reposer sur la volonté ou l’ambition d’un seul homme, aussi compétent ou visionnaire soit-il. Les institutions, lorsqu’elles sont respectées, et le peuple, lorsqu’il approuve, constituent le véritable rempart contre l’instabilité. L’expérience burkinabè de 2014 illustre crûment qu’ignorer les signaux d’alerte peut conduire à des conséquences irréversibles.
Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire a l’occasion de montrer qu’elle a appris des erreurs du passé, chez elle comme chez ses voisins. En choisissant de ne pas briguer un quatrième mandat, le président Ouattara inscrirait son nom dans l’histoire comme celui qui a privilégié la paix et la stabilité à l’ambition personnelle.
La paix est fragile. Elle ne s’entretient pas seulement par les discours, mais par des gestes forts et symboliques. Elle n’est donc pas de vains mots, mais un comportement. Renoncer, c’est protéger la nation. Et c’est, parfois, la plus grande victoire d’un homme d’État.
La Rédaction
Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur :  Suivre la chaine
Suivre la chaine