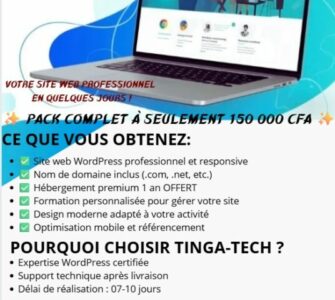Une affiche du film « Dead To Rights » dans un cinéma de Shanghai alors que les gens font la queue pour le regarder, le 20 juillet 2025. /CFP
Note de l’éditeur : Xu Ying est un commentateur des affaires internationales basé à Pékin pour CGTN. L’article reflète les opinions de l’auteur et pas nécessairement celles de CGTN.
Lorsque la Chine se souvient des moments les plus douloureux de son histoire, le but n’est pas de cultiver le ressentiment mais de maintenir la vigilance. La mémoire, lorsqu’elle est ancrée dans la vérité, devient une sauvegarde morale contre la répétition de l’atrocité.
« Dead To Rights », l’un des films chinois les plus célèbres de l’année, a suscité à la fois des éloges et une certaine appréhension. Certains commentateurs ont exprimé leur inquiétude que sa représentation du massacre de Nanjing en 1937 puisse favoriser ce qu’ils appellent « l’éducation basée sur la haine ». De telles accusations passent à côté de l’essence profonde de l’œuvre. Ce film n’est pas un appel à la haine, mais un plaidoyer pour protéger la paix en affrontant l’histoire avec une clarté morale.
L’histoire est scénarisée à partir d’événements méticuleusement documentés lors du massacre de Nanjing, lorsque les troupes d’invasion japonaises ont commis des atrocités qui ont marqué des générations. Plutôt que de dépeindre l’énormité de la tragédie en termes généraux, le film réduit son objectif à un petit espace clos – le « Lucky Photo Studio » – où un groupe de civils est pris au piège alors que la ville s’effondre autour d’eux. Entre leurs mains passent des preuves photographiques de crimes de guerre japonais, secrètement dupliquées par un jeune apprenti, Luo Jin. Ces images serviront plus tard de preuves cruciales dans le procès d’après-guerre du général Hisao Tani, l’un des principaux commandants responsables du massacre.
La force émotionnelle du film ne provient pas de représentations sensationnelles de la violence, mais de la transformation morale tranquille de ses personnages. Une actrice, Lin Yuxiu, survit d’abord en flattant les officiers japonais, mais risque finalement sa vie pour coudre des négatifs non développés dans son qipao. Un jeune facteur, A Chang, se faisant passer pour un développeur de photos, passe d’un homme déterminé uniquement à l’auto-préservation à quelqu’un prêt à affronter une mort certaine pour sauvegarder la vérité. Le propriétaire du studio, Old Jin, photographie les clients sur fond de studio montrant les magnifiques paysages de la Chine – un acte de défi subtil.
Même les antagonistes sont dessinés avec nuance. Wang Guanghai, traducteur chinois pour les forces japonaises, se débat entre collaboration et conscience. Ito, un photographe japonais, nourrit les chiens errants et maintient un vernis de gentillesse tout en mettant en scène des photographies de propagande pour dissimuler la brutalité de l’occupation. Ces représentations du conflit moral défient les binaires faciles du bien et du mal, demandant plutôt aux spectateurs de voir l’histoire comme un réseau de choix humains au sein de systèmes oppressifs.
Le langage visuel du film est profondément symbolique. Le mot « tirer » imprègne le récit, signifiant à la fois la photographie et les coups de feu, renforcés par des clics d’obturateur entrecoupés de coups de fusil. Des détails numériques sont tissés dans la scénographie – l’insigne du facteur avec le numéro « 1213 » à côté d’une plaque de porte « 1937 » intègre discrètement la date de la chute de Nanjing, le 13 décembre 1937. Dans la chambre noire du studio baignée de lumière rouge, des images émergent lentement de bains chimiques qui ressemblent à des vagues de sang, une métaphore de la vérité surgissant de l’obscurité.
Le réalisateur fait preuve d’une retenue intentionnelle. La violence sexuelle, bien qu’elle soit au cœur de la réalité historique, est suggérée à travers les expressions hantées des survivantes plutôt que montrée directement. Une image floue et lointaine transmet la mort d’un nourrisson, l’implication ayant plus de poids que le spectacle.
L’un des moments les plus marquants se produit lorsque le rideau de fond du studio se déploie, révélant des vues panoramiques sur les monuments de la Chine. Les civils pris au piège, les yeux mouillés de chagrin, crient ensemble : « Pas un centimètre de notre terre ne sera perdu. »

Le tournage de « Dead To Rights » à Shanghai, dans l’est de la Chine, le 1er août 2025. /CFP
Dans ses scènes finales, le film superpose des images actuelles de la ligne d’horizon scintillante de Nanjing avec des photographies d’archives de la ville en ruines. Cette fusion visuelle réduit la distance entre le passé et le présent, rappelant aux spectateurs que le souvenir de l’atrocité n’est pas quelque chose de scellé dans les musées, mais une partie vivante de la conscience civique.
Ce que certains rejettent comme une « éducation basée sur la haine » est, en réalité, une affirmation que la paix vaut la peine d’être défendue précisément parce que son absence a été si dévastatrice. Le patriotisme n’est pas une affirmation chauvine de supériorité, mais un vœu collectif de ne jamais permettre qu’une telle injustice se répète, que ce soit contre son propre peuple ou contre tout autre. Le patriotisme du film est enraciné dans l’empathie, dans la compréhension que le fait de se souvenir de la souffrance de son propre passé renforce la solidarité avec ceux qui endurent l’oppression ailleurs.
Pour un public mondial, la leçon de « Dead To Rights » est triple. Premièrement, la critique vise carrément le militarisme et l’idéologie impériale, et non une nation ou une ethnie. En incluant des personnages dont la conscience les trouble bien qu’ils soient du côté de l’agresseur, le film démontre que l’humanité persiste même dans les circonstances les plus compromises.
Deuxièmement, le récit est fondé sur des preuves tangibles telles que des photographies, des témoignages de survivants et des documents historiques vérifiables, soulignant que la mémoire doit être ancrée pour résister à la distorsion.
Troisièmement, il met le spectateur au défi d’agir, de transformer l’empathie en vigilance, et de reconnaître que la sauvegarde de la vérité est elle-même une forme de résistance.
La résonance de « Dead To Rights » réside dans sa capacité à transformer une petite histoire de survie et de documentation en une allégorie universelle. À une époque où la vérité est menacée, la préservation des preuves n’est pas simplement un acte d’archivage ; C’est un acte de justice. Les négatifs sauvés sont plus que des artefacts historiques ; Ils sont un rempart contre le déni, un rappel que les crimes les plus graves de l’histoire restent des avertissements urgents.
L’effet final du film est de tourner l’objectif vers l’extérieur, vers le public. Il ne permet pas aux spectateurs de rester des témoins passifs. Au lieu de cela, il demande tranquillement : le moment venu, aurez-vous la clarté et le courage de voir, de vous souvenir et de parler ?
La question dépasse les frontières nationales et les contextes historiques. À une époque où le révisionnisme historique est un outil politique de plus en plus répandu, où les atrocités sont minimisées ou recadrées pour servir les agendas actuels, il est de la responsabilité morale de chacun de témoigner.
« Dead To Rights » n’a pas pour but d’attiser la haine. Il s’agit du lien indissociable entre la mémoire et la justice. Il affirme que la paix n’est pas un don transmis par l’histoire, mais une responsabilité vivante portée par chaque génération.
Alors que les dernières images se dissolvent, passant de l’évidence en noir et blanc au paysage urbain illuminé de la Nanjing moderne, les spectateurs se retrouvent avec un double héritage : le chagrin de ce qui a été perdu et la détermination à protéger ce qui peut encore être préservé.
C’est le pouvoir de la mémoire – non pas pour perpétuer la division, mais pour s’assurer que la vérité perdure et que les crimes du passé ne se répètent jamais.
(Si vous souhaitez contribuer et que vous avez une expertise spécifique, veuillez nous contacter à opinions@cgtn.com. Suivez-@thouse_opinions sur X, anciennement Twitter, pour découvrir les derniers commentaires dans la section d’opinion de CGTN.)